XVIIe siècle
-
-
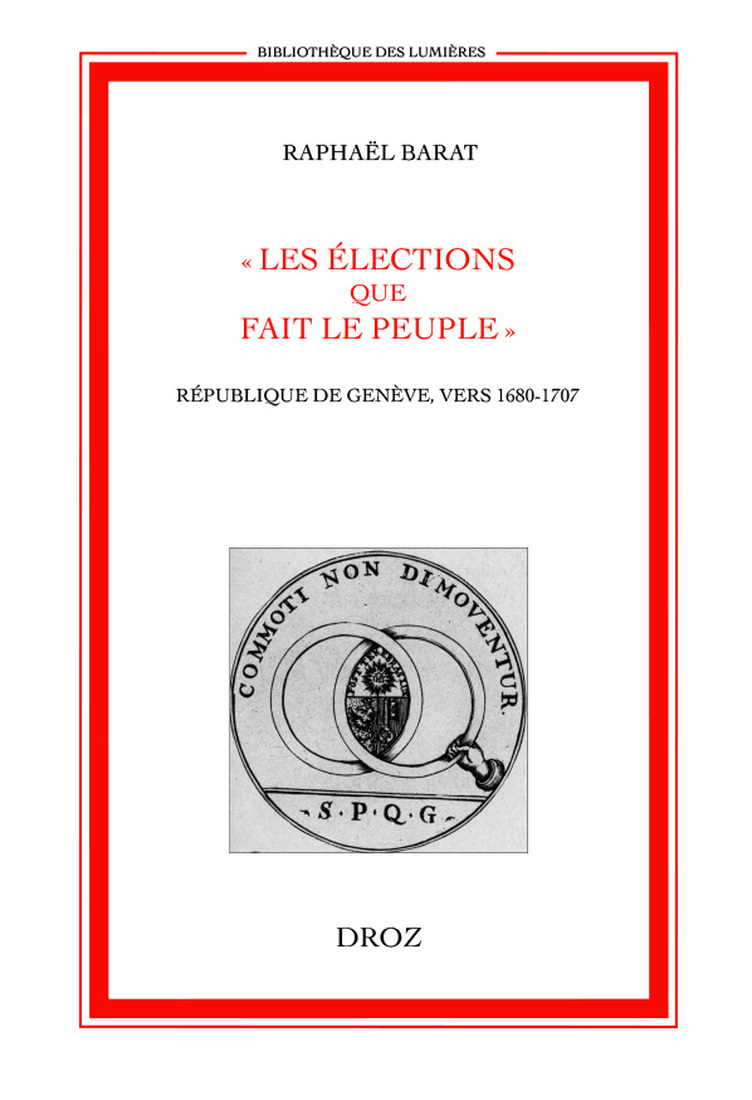
Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, alors que des régimes patriciens ont triomphé dans la plupart des républiques européennes, la République de Genève reste une démocratie de jure, où la souveraineté appartient au Conseil général, assemblée de tous les bourgeois et citoyens. Néanmoins, cette souveraineté théorique survit seulement dans des élections que l’historiographie a souvent réduites à des simulacres, la République étant aristocratique de facto. Comment comprendre alors ce qui se passe quand il ne se passe rien, et raconter l’histoire de ces élections « que fait le peuple » ? Raphaël Barat met d'une part à jour les ressorts de la domination aristocratique dans ces élections populaires, de la théorie politique à l'organisation même de l'espace de vote le jour de l'élection, en passant par l’analyse des carrières politiques des magistrats. Il montre d'autre part avec sagacité que des grains de sable se glissent parfois dans les rouages, que les électeurs se départissent dans certaines circonstances de leur déférence habituelle, et que des tensions apparaissent quand ces derniers ne sont plus sûrs de pouvoir honorer le serment qu'on leur fait prêter d'élire « ceux qui sont idoines ». Le cas de la République de Genève permet ainsi de mieux comprendre les enjeux et les pratiques du vote d'Ancien Régime, nouveau terrain d'enquête pour les historiens de la période moderne.
-

Le divertissement, la fête, le rire sont des besoins que, pour exorciser les inquiétudes de la vie quotidienne, nous éprouvons tous. Cela est encore plus vrai dans les sociétés soumises à une discipline sévère ou confrontées à des événements douloureux. Les XVIe et XVIIe siècles ont su créer ces espaces d’exception. Ils ont réservé une place aux bouffons et aux farceurs, à l’expression publique de l’exubérance et de la gaieté, ils ont su contourner les interdits pour libérer l’énergie vitale de ses entraves. La littérature tient sa part dans ce grand jeu. Au XVIe siècle, Erasme, Rabelais, Montaigne, quelques autres docteurs en gai savoir affirment la légitimité du plaisir. Lorsque l’ordre moral et la police des idées se resserrent, au XVIIe siècle, des écrivains prennent la relève, remplissant dans la société la même fonction que le fou à la cour. Ce sont des bohèmes, des saltimbanques, des lettrés plus ou moins libertins qui incarnent ou mettent en scène la joie pour la faire advenir. Si Molière joue ce rôle à la perfection, toute une faune littéraire, à ses côtés, s’emploie à créer des mondes où l’homme, en accord avec son désir, peut s’épanouir.
-
-

Sommaire/Contents: F. DUVAL, "Conflit d'interprétations : typologie des facteurs de choix éditoriaux"; G. DECLERCQ, "La mise en livre des archives du haut moyen âge : le cas du second liber traditionum de l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin (milieu du xr• siècle)"; N. LAURENT-BONNE, "Notes sur deux canonistes méridionaux du XIVe siècle: Guillaume de Rosières et Aymeric de Montal"; A. BRUX, "Une réécriture méconnue des Grandes Chroniques de France: signalement, tradition manuscrite, sources"; É. FAISANT, "François Gabriel et les du Cerceau : la correspondance inédite d'un architecte provincial à la fin du XVIe siècle"; M. STOLL, "« Ils étaient comme de petits dieux ... » : les conseillers au Conseil royal des finances,
1661-1715"; M. FRIEDRICH, "Les feudistes-experts des archives au XVIIIe siècle : recherche des documents, généalogie et savoir-faire archivistique dans la France rurale" - Mélanges - P. BOURGAIN, "A la recherche des caractères propres aux manuscrits d'auteur médiévaux latins"; G. PASTORE et F. DUVAL, "La tradition française de l'Infortiat et le Livre de jostice et de plet"; M. CASSAN, "Engagement et appartenances: les vies des magistrats Étienne de Lestang (1510-1581) et Antoine de Lestang (1541-1617)"; J. DELMULLE, "Un mécèné en disgrâce: l'épître dédicatoire retrouvée de la Bibiotheca Coisliniana (1715)"; R. ALLEN, "Un nouvel acte de Guillaume le Bâtard, duc de Normandie (18 juin 1066)"; P.-V. CLAVERIE, "Les origines génoises de la famille Carròs"; B. HERENCIA, "Éphémérides du citoyen et Nouvelles éphémèrides économiques : vicissitudes éditoriales et signatures" - Bibliographie - Chronique - Résumés - Table alphabétique.
Sommaire/Contents: F. DUVAL, "Conflit d'interprétations : typologie des facteurs de choix éditoriaux"; G. DECLERCQ, "La mise en livre des archives du haut moyen âge : le cas du second liber traditionum de l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont-Blandin (milieu du xr• siècle)"; N. LAURENT-BONNE, "Notes sur deux canonistes méridionaux du XIVe siècle: Guillaume de Rosières et Aymeric de Montal"; A. BRUX, "Une réécriture méconnue des Grandes Chroniques de France: signalement, tradition manuscrite, sources"; É. FAISANT, "François Gabriel et les du Cerceau : la correspondance inédite d'un architecte provincial à la fin du XVIe siècle"; M. STOLL, "« Ils étaient comme de petits dieux ... » : les conseillers au Conseil royal des finances,
1661-1715"; M. FRIEDRICH, "Les feudistes-experts des archives au XVIIIe siècle : recherche des documents, généalogie et savoir-faire archivistique dans la France rurale" - Mélanges - P. BOURGAIN, "A la recherche des caractères propres aux manuscrits d'auteur médiévaux latins"; G. PASTORE et F. DUVAL, "La tradition française de l'Infortiat et le Livre de jostice et de plet"; M. CASSAN, "Engagement et appartenances: les vies des magistrats Étienne de Lestang (1510-1581) et Antoine de Lestang (1541-1617)"; J. DELMULLE, "Un mécèné en disgrâce: l'épître dédicatoire retrouvée de la Bibiotheca Coisliniana (1715)"; R. ALLEN, "Un nouvel acte de Guillaume le Bâtard, duc de Normandie (18 juin 1066)"; P.-V. CLAVERIE, "Les origines génoises de la famille Carròs"; B. HERENCIA, "Éphémérides du citoyen et Nouvelles éphémèrides économiques : vicissitudes éditoriales et signatures" - Bibliographie - Chronique - Résumés - Table alphabétique.
-
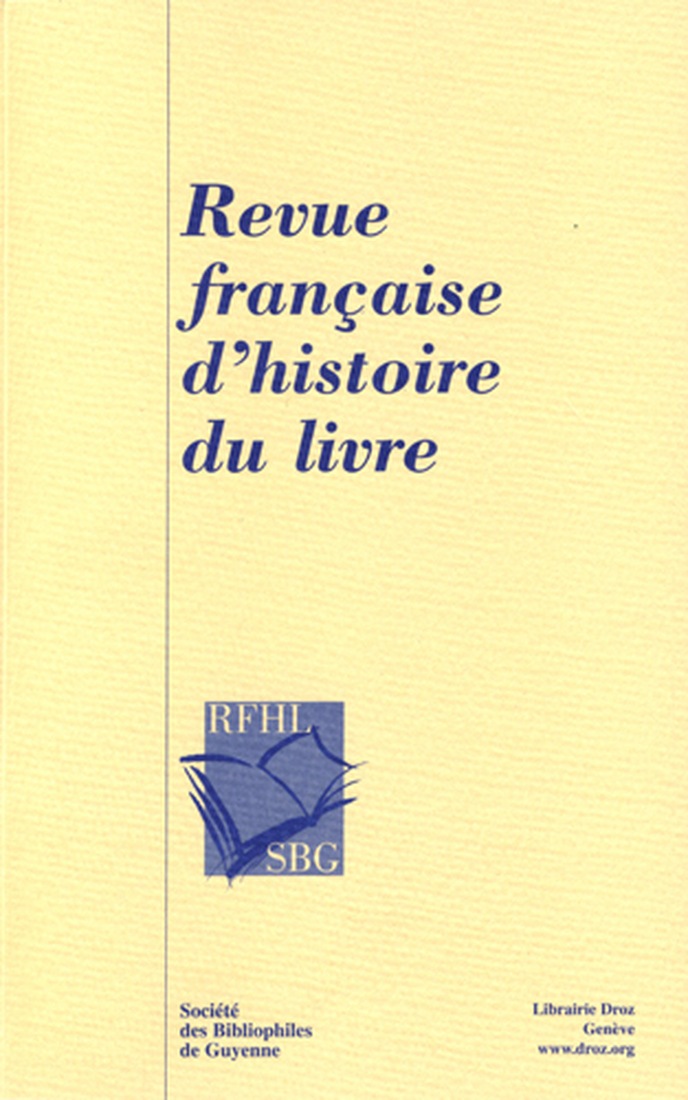
Sommaire
I. Etudes - Samuel GRAS, "L'atelier de Jean Poyer à Madrid. Un missel au temps des fiançailles de Charles VIII et Marguerite d'Autriche"; Annalisa MASTELOTTO, "Au fil des pages: les notes marginales de l'exemplaire de travail de la Bibliotheca Universalis de Gesner consacrées aux auteurs italiens"; Evelien CHAYES, "Bibliothèques bordelaises à l'époque de Montaigne"; Dominique VIDAL, "Le Théâtre d'Agriculture et mesnage des champs, d'Olivier de Serres dans les catalogues de ventes de bibliothèques au XVIIIe siècle, de Jacques-Auguste de Thou à Jean-Baptiste Huzard"; Peter NAHON, "Un regard bordelais sur le rite comtadin en 1847, assorti de quelques notes sur la disparition de celui-ci"; Michel WIEDEMANN et Pierre COUDROY DE LILLE, "Les hommes illustres de Plutarque à nos jours: à propos d'une collection de François Séraphin Delpech"; Christophe BLANQUIE,: "L'érudit, l'évêque et le ministre: le premier Tamizey de Larroque"; Xavier ROSAN, "L'écrivain Louis Emié (1900-1967) et les arts"; Nathalie DIETSCHY, "Le livre d'artiste: au-delà de la page à l'ère digitale" - II. Variétés - André GALLET, "Corisande, Henri de Navarre et Montaigne"; Gilles DUVAL; "Registre de sommet et Cartes de visite, des imprimés parfois négligés: l'exemple du Pic Long (3.192 m), 1928-1939".
-
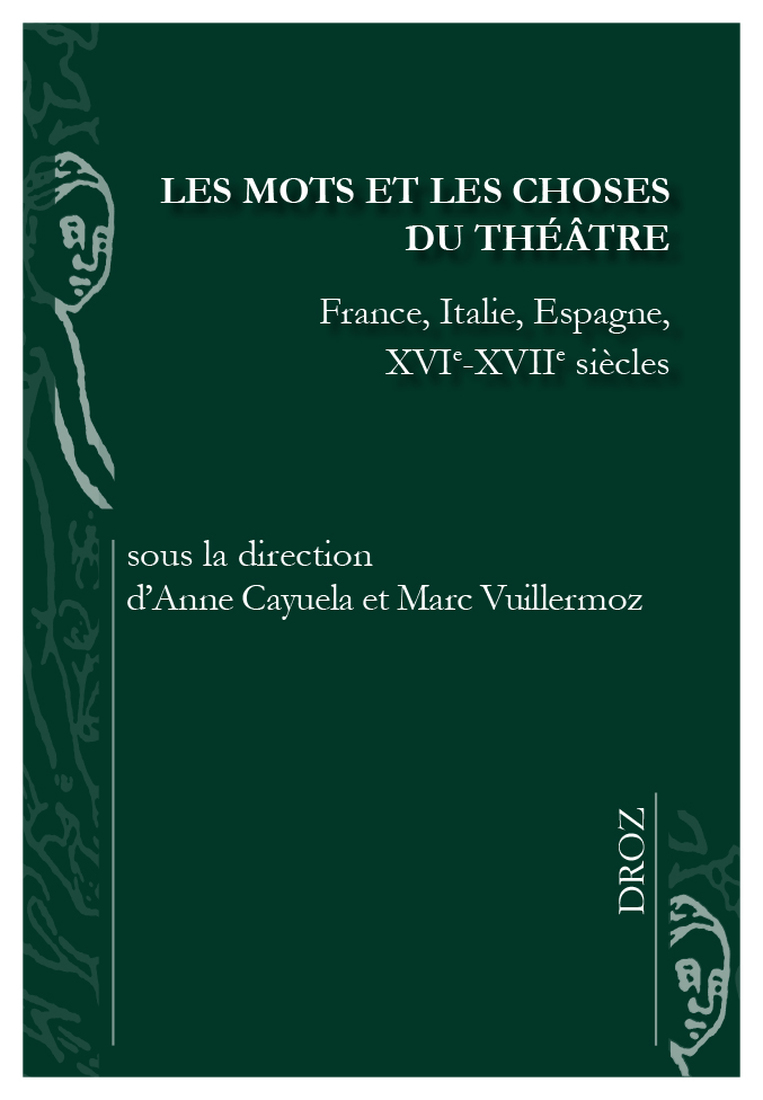
Table des matières
Anne CAYUELA, Marc VUILLERMOZ
Avant-propos
Chapitre premier – L’auteur dramatique
Sandrine BLONDET
De la sueur, du temps et des armes. Les Mots du travail dramatique
Philippe MEUNIER
Du texte au paratexte : histoire de quelques métaphores animales du poète et de ses plagiaires
Emmanuelle HENIN
La métaphore picturale dans le paratexte théâtral : l’exemple de Scudéry
Marine SOUCHIER
De « l’excellent poète » au « rimailleur » : enquête sur la charge axiologique des diverses dénominations de l’auteur dramatique
Juan Carlos GARROT
La perspective du poète : lecture et représentation dans les préliminaires caldéroniens
Chapitre II – Esthétique et dramaturgie
Enrica ZANIN
Les choses du théâtre dans les premiers dictionnaires italiens,français et espagnols
Fausta ANTONUCCI
Escena, cena, paso : las particiones internas al acto o jornada en textos teatrales y teóricos del Siglo de Oro
Marc DOUGUET
L’horreur du vide. Analyse terminologique de la notion de « liaison des scènes » dans la théorie dramatique française
Chapitre III – Les genres dramatiques
Christophe COUDERC
Paratexte et taxinomie. Sur quelques désignations génériques du théâtre espagnol
Coline PIOT
« Farce » ou « petite comédie » ? Les enjeux du processus d’identification d’un nouveau genre (1660-1670)
Emmanuele DE LUCA
Lazzo : enjeux poétiques et esthétiques d’un intraduisible italien au XVIIe siècle français
Chapitre IV – L’acteur et le personnage
Véronique LOCHERT, Bénédicte LOUVAT
Jouer, réciter, déclamer : les mots du jeu en France, en Espagne et en Italie
Teresa JAROSZEWSKA
Un capitan italien en costume espagnol sur la scène française. Les dénominations de soldats fanfarons aux XVIe et XVIIe siècles
Chapitre V – Réception
Céline FOURNIAL
Lope de Vega à la lettre : la réception de l’Arte nuevo de hacer comedias en France
Patrizia De CAPITANI
Le langage figuré dans les prologues des comédies italiennes et françaises du XVIe siècle : un enjeu de réception
Hélène TROPÉ
Les mots et les choses du rire dans les théâtres français et espagnols des XVIe et XVIIe siècles
Stéphane MIGLIERINA
Rire et suavité, entre traités religieux et textes liminaires théâtraux
Index des noms
Index des pièces
-
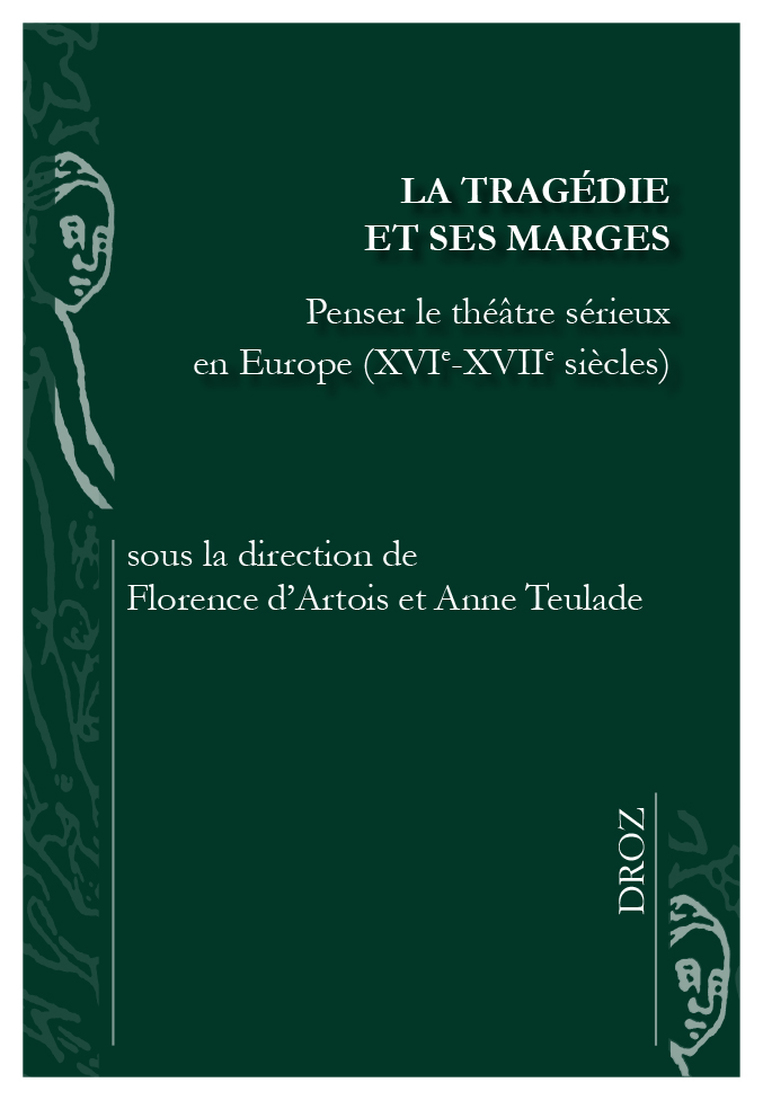
Table des matières
Introduction
PREMIÈRE PARTIE. PENSÉES THÉORIQUES ET NON THÉORIQUES
Chapitre premier. La négociation des traités avec les formes modernes
Florence d’Artois
Qu’est-ce qu’une « tragédie éthique » ? Ambiguïté de l’èthos dans les poétiques néo-aristotéliciennes italiennes et espagnoles
Enrica Zanin
La tragédie à fin heureuse ou comment une forme aristotélicienne est rejetée par les néo-aristotéliciens (Italie, France, Espagne)
Chapitre II. La pensée des discours non savants
François Lecercle
La tragédie est une comédie qui s’ignore : brouillages et partages dans la polémique théâtrale, en France, dans la première moitié du XVIIe siècle
Lise Michel
Objets et pratiques des commentaires non savants sur la tragédie (France, 1660-1670)
DEUXIÈME PARTIE. TRADUCTIONS ET IMITATIONS : LA RÉÉCRITURE, CREUSET DE PROPOSITIONS
Chapitre III. Expérimentations savantes
Marie Saint Martin
La tragédie avant la tragédie : Les premières traductions du théâtre grec en langue vernaculaire
Line Cottegnies
Une pièce romaine pour quoi faire ? Antonius de Mary Sidney Herbert (1592) ou le closet drama en question
Chapitre IV. Revivifier le spectacle tragique, entre douceur et violence
Danielle Boillet
La tragédie à Bologne dans le sillage de Circé : La « Medea essule » (1602) de M. Zoppio
Zoé Schweitzer
Du dénouement spectaculaire comme critère
TROISIÈME PARTIE. HYBRIDATION ET REDÉPLOIEMENTS. DISSOLUTION OU PENSÉE DES FRONTIÈRES GÉNÉRIQUES ?
Chapitre V. Usage des topoï épiques : transitions et expérimentations
Jean Canavaggio
La Numancia de Cervantès, de comedia à tragedia
Fausta Antonucci
Le siège d’une ville comme sujet dramatique dans les premières années de la Comedia Nueva et son lien à la tragédie
Tiphaine Karsenti
Les scènes de bataille dans la tragédie française au tournant des XVIe et XVIIe siècles
Chapitre VI. La rénovation de la tragédie par l’absorption des genres mixtes
Fabien Cavaillé
La tragédie aux champs : emprunts pastoraux et pensée des frontières génériques dans les tragédies d’amour françaises (1600-1635)
Alban Déléris
Quand la tragédie dégénère : l’« effet monstre » dans les théâtres français et anglais au tournant des XVIe et XVIIe siècles
Bénédicte Louvat-Molozay
Deux moments de refondation du genre tragique en France : la tragédie des années 1630 et la tragédie en musique des années 1670
Françoise Decroisette
Retour à l’horreur tragique dans les tragedie per musicade Girolamo Frigimelica Roberti (1653-1732)
Chapitre VII. L’intégration des effets comiques : distanciation, parodie ou réactivation de l’efficacité tragique ?
Juan Carlos Garrot Zambrana
Los malcasados de Valencia ou la tragédie et la farce déjouées
Stéphane Miglierina
Les tragédies d’un comico : théâtre sérieux et comédie du pouvoir chez Niccolò Biancolelli
Marcella Trambaioli
Farce à la manière d’une tragédie : nouvelles réflexions sur la fête théâtrale courtisane dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles par rapport au théâtre tragique
QUATRIÈME PARTIE. LE THÉÂTRE SÉRIEUX À L’ÉPREUVE DE SES DEHORS : CONFRONTATIONS À LA CULTURE DE LA PREMIÈRE MODERNITÉ
Chapitre VIII. La porosité aux discours non dramatiques (discours, philosophie, histoire et morale)
Enrica Zanin
« Il dialogo all’altezza della tragedia » : proximité entre dialogue et tragédie (Italie, France 1550-1630)
Guillaume Navaud
Le chaud et le froid. Tragédie, histoire et philosophie dans l’Angleterre de la Renaissance
Christine Sukic
« Stages too / Have a respect due to them » : The Revengeof Bussy D’Ambois (1613), une tragédie à la marge
Chapitre IX. L’accommodation du théâtre sérieux à la culture post-tridentine
Bruna Filippi
La tragédie chrétienne jésuite en Italie entre édification spirituelle et morale (XVIIe siècle)
Cécile Berger
Les choix esthétiques de Giovan Battista Andreini dans L’Adamo(1613), sacra rappresentazione à l’image d’une conception divine du monde
Isabel Ibáñez
De l’incompatibilité entre hagiographie et tragédie :La Ninfa del Cielo de Tirso de Molina
Yves Germain
La part du Démon, une possible inflexion tragique au sein de l’auto sacramental caldéronien ?
Barbara Selmeci Castioni
Heurs et leurres de la tragi-comédie chrétienne. Les deux Josaphat de Magnon et D.L.T
Chapitre X. Livrer un regard sur le monde contemporain
Anne Wagniart
La tragédie protestante allemande des XVIe-XVIIe siècles
Anne Teulade
Une tragédie d’actualité est-elle possible ? Parler aux émotions et aux croyances des spectateurs
Bibliographie
Index
Les auteurs
La renaissance de la tragédie s’accompagne, aux XVIe et XVIIe siècles en Europe, de l’éclosion de formes dramatiques qui se situent à ses marges, sans pour autant être marginales. La tragédie occupe alors une position à la fois centrale et décentrée au sein d’un ensemble mobile et plus vaste, que l’on peut qualifier de théâtre sérieux. Il fallait penser cette place et modéliser les relations dynamiques et complexes entre la tragédie et ces autres formes. Cet ouvrage revisite également les usages de ce théâtre, interrogeant par exemple la place dévolue au théâtre didactique, les types d’émotions engagés par les fictions à sujet grave, la mobilisation éventuelle d’un décryptage allégorique et la possibilité de parler de « drame » épique. Enfin, il s’intéresse à la manière dont les poètes accommodent les différentes formes de théâtre sérieux aux enjeux d’un monde nouveau, prenant acte d’un changement de paradigme culturel : comment un théâtre érudit ou commercial, dans tous les cas non liturgique, peut-il prendre en charge les récits religieux, biblique ou hagiographique ? Qu’en est-il de la représentation de l’histoire nationale, notamment dans les puissantes monarchies qui sont en train de se constituer, en Espagne, en France et en Angleterre ? Dans quelle mesure le retour au premier plan de formes héritées de l’Antiquité s’accompagne-t-il de ces préoccupations idéologiques nouvelles ?
-

Table des matières
Préface François-Xavier CUCHE
I. Image, imaginaire
Laurent MATTIUSSI, Fénelon et la réévaluation de l’image : le tournant moderne
Christian BELIN, L’image insensible chez Fénelon
Hélène MICHON, Image, idée et désir de Dieu dans les écrits spirituels de Fénelon
Benedetta PAPASOGLI, Fénelon et les « anthropologies » de Dieu
Delphine REGUIG, Sublime et transparence des images dans les Dialogues sur l’éloquence de Fénelon
Alain CANTILLON, Les Aventures de Télémaque : jeu des images, jeu de l’imagination
II. ASPECTS DE L’IMAGINATION FÉNELONIENNE
Bernard TEYSSANDIER, De quoi Mentor est-il l’image ?
Volker KAPP, L’image de l’enfant dans l’œuvre de Fénelon
Isabelle TRIVISANI-MOREAU, Le pinceau sous la plume : l’image dans les fables et opuscules pédagogiques de Fénelon
Eric TOURRETTE, Les images gelées
III. FÉNELON ET LES ARTS
Odile DUSSUD, Couleurs antiques
Patricia TOUBOUL, La mémoire comme « cabinet de peintures ». Une métaphore convenue du discours fénelonien ?
Alain BRUNN, « On voudrait y être » : le regard modeste du peintre. L’image, sa fabrique et son appropriation dans les Dialogues des morts (LII et LIII) de Fénelon
Jacomo FUK, Fénelon chez Louis Marin
IV. STYLISTIQUE ET RHÉTORIQUE DE L’IMAGE
Françoise BERLAN, Représenter, représentation chez Fénelon
Laurent SUSINI, Que donne à voir le feu sortant des yeux de Calypso ? Clichage et prudence dans le Télémaque de Fénelon
Agathe MEZZADRI, Un impensé du style fénelonien : la métaphore du ruisseau
V. ILLUSTRER FÉNELON
Marie-Claire PLANCHE, Physionomies de Fénelon
Olivier LEPLATRE, La carte et le livre (Les Aventures de Télémaque)
Pierre MICHEL, De l’enfance d’un chef à l’âge d’homme : images pour un Télémaque romantique
Emblème d’un siècle ambivalent vis-à-vis des arts de représentation, iconolâtre autant qu’iconophobe, Fénelon témoigne dans son œuvre d’un complexe du visible. Chez lui, dialoguent en tension les plus grandes réticences et l’intérêt stratégique voire le goût profond pour l’image. Les études rassemblées ici sondent et comparent les divers pans d’un corpus divers qui assemble fictions, essais pédagogiques et esthétiques, et bien entendu prose spirituelle. Ce balayage permet une grande pluralité des approches qui saisissent les enjeux et les soubassements d’une pensée, d’une croyance et d’une sensibilité à la fois inquiétées et passionnées par le pouvoir de l’image. Pour partie, Fénelon met en soupçon, éventuellement refuse les images, jugées risquées parce que séductrices, trompeuses, illusoires. Mais il sait aussi ne pouvoir se passer du régime de l’image, concrète et mentale, pour toucher et persuader les hommes auxquels il s’adresse et que les sens rendent incapables de s’élever spontanément à l’abstraction des idées ou de la foi.
Le lecteur trouvera dans ce volume un croisement de perspectives : spirituelles, littéraires, stylistiques, esthétiques, didactiques, éditoriales… L’enquête conclut à la place centrale et éminemment problématique que l’œuvre de Fénelon n’a cessé d’entretenir avec les différents modes de la figuration.
-
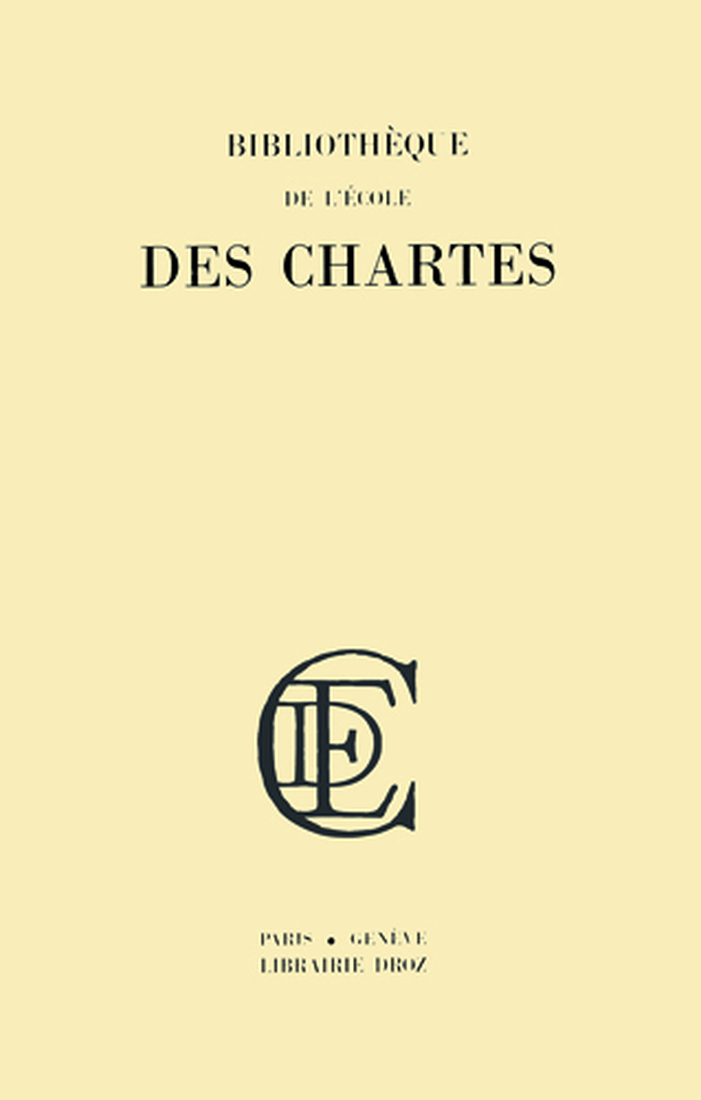
Sommaire: E. Chapron, J. Boutier, « Utiliser, archiver, éditer. Usages savants de la correspondance en Europe, xviie-xviiie siècles »; M. Greengrass, L. Penman, « L’ombre des archives dans les cultures du savoir du xviie siècle : les papiers de Samuel Hartlib (v. 1600-1662) »; J. Boutier, A. Bruschi, « Dans les ‘‘armoires’’ de Baluze : constitution, organisation et pratiques des archives épistolaires d’un savant au Grand Siècle »; M. Stuber, « Les archives épistolaires d’Albrecht von Haller : Formation, perception, réception d’une correspondance »; A. Saada, « La pratique de la correspondance de Christian Gottlob Heyne (1763-1812) : annoter, administrer, archiver »; P. Bret, « La correspondance de Lavoisier : pratiques matérielles de la lettre dans un corpus savant des Lumières » - Mélanges - P. Bourgain, « À la recherche des caractères propres aux manuscrits d’auteur médiévaux latins »; G. Pastore, F. Duval, « La tradition française de l’Infortiat le Livre de jostice et de plet »; M. Cassan, « Engagement et appartenances : les vies des magistrats Étienne de Lestang (1510-1581) et Antoine de Lestang (1541-1617) »; J. Delmulle, « Un mécène en disgrâce : l’épître dédicatoire retrouvée de la Bibliotheca Coisliniana (1715) » - Bibliographie - Comptes rendus critiques - Notes de lecture - Résumés.
Sommaire: E. Chapron, J. Boutier, « Utiliser, archiver, éditer. Usages savants de la correspondance en Europe, xviie-xviiie siècles »; M. Greengrass, L. Penman, « L’ombre des archives dans les cultures du savoir du xviie siècle : les papiers de Samuel Hartlib (v. 1600-1662) »; J. Boutier, A. Bruschi, « Dans les ‘‘armoires’’ de Baluze : constitution, organisation et pratiques des archives épistolaires d’un savant au Grand Siècle »; M. Stuber, « Les archives épistolaires d’Albrecht von Haller : Formation, perception, réception d’une correspondance »; A. Saada, « La pratique de la correspondance de Christian Gottlob Heyne (1763-1812) : annoter, administrer, archiver »; P. Bret, « La correspondance de Lavoisier : pratiques matérielles de la lettre dans un corpus savant des Lumières » - Mélanges - P. Bourgain, « À la recherche des caractères propres aux manuscrits d’auteur médiévaux latins »; G. Pastore, F. Duval, « La tradition française de l’Infortiat le Livre de jostice et de plet »; M. Cassan, « Engagement et appartenances : les vies des magistrats Étienne de Lestang (1510-1581) et Antoine de Lestang (1541-1617) »; J. Delmulle, « Un mécène en disgrâce : l’épître dédicatoire retrouvée de la Bibliotheca Coisliniana (1715) » - Bibliographie - Comptes rendus critiques - Notes de lecture - Résumés.